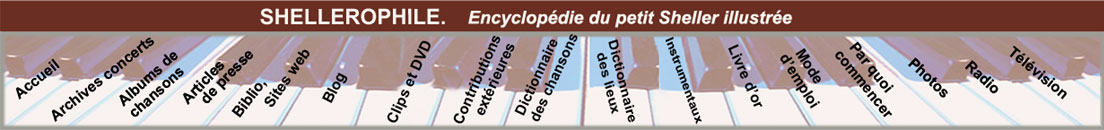William
Sheller a vendu plus de 500 000 exemplaires de son exercice au piano acoustique
: Sheller en solitaire. Il surprend avec son nouvel album, Albion,
qualifié d' «électrique». Dix titres noyés dans
les guitares et enregistrés en Angleterre avec trois musiciens rock. Il
revient sur l'époque et sur celles qui l'ont précédée.
Esthétiques croisées.
EN 1967, Sergeant
Pepper, des Beatles, avait détourné le compositeur William
Sheller de ses études classiques. En 1975, Rock’n’dollars le propulsait au sommet des hit-parades. Depuis, le musicienchanteur multiplie
les expériences musicales, du «symphonique alternatif» au très
touffu Albion, qui le ramène en Angleterre. «Les grandes
tempêtes futuristes se sont calmées», explique William
Sheller, installé devant un ordinateur, dans la pénombre du bureau
où il compose, où il vit en musique. «Nous sommes revenus
du futur», poursuit-il, -lunettes rondes, robe de chambre en soie,
amabilité courtoise - en jouant avec le clavier, laissant défiler
sur l'écran les partitions en chantier. «On fait aujourd'hui
avec ce que l'on a. On n'écrit plus pour la postérité, mais
pour l'immédiat.» Cet an 2000, tant fantasmé, est à
nos portes. Où en est-on? «Dans les années 50 - j'étais
gamin -, on imaginait qu'on irait passer les week-ends dans les stations spatiales
de l'an 2000. Rien ne s'est produit et c'est une grande déception.»
-
«Quelle est votre idée de l'esthétique des années 90
?»
- «Nous avons aujourd'hui un siècle
d'audiovisuel derrière nous. Dans notre quotidien, les images de la vie,
des gens, de 1895, de 1940 ou de 1960 se sont mélangées. On entend
à la radio aussi bien une chanson ou une œuvre conçue en 1960
qu'en 1990. Le passé fait ainsi partie de notre présent. Et l'on
a tendance à reprendre, parfois dans les détails, des esthétiques,
comme le surréalisme, qui, à l'époque où elles sont
apparues, avaient créé des chocs. Tout cela forme aujourd'hui l'ensemble
de notre culture. La propagation planétaire, par les disques notamment,
et les innovations techniques vont dans le sens de l'accumulation. On peut aujourd'hui
reproduire des sons d'époque, les coller, comme un architecte qui peut
changer de style dans une même bâtisse, jouer avec les années
30, 40 ou 50 et rester totalement contemporain.»
-
«Dans ce contexte, que représente Albion?»
- «C'est un discours musical sur l'Angleterre. La pochette [un
assemblage d'images surréalistes habillées de carreaux géométriques
noirs et blancs] colle bien. C'est un mélange des genres : Alice au
pays des merveilles, Jean Cocteau, le pop-art. Pour réaliser cet album,
que je voulais «rock», je me suis tourné vers l'Angleterre.
D'où son titre, Albion, un nom que, dit-on, les Grecs ont inventé
en voyant les falaises blanches, et qui fut repris par les Ecossais, agrémenté
de l'adjectif «perfide». Albion agit comme une brume, c'est une métaphore
pour ne pas dire made in England.»
L'histoire de ce disque
est un état de grâce : tout au long de sa réalisation, les
bonnes réponses sont venues au bon moment. Il y a trois ans, j'avais parlé
à Phonogram de mon projet d'enregistrer un album «électrique».
Je voulais des musiciens de rock, car le rock perturbe. Or, j'ai besoin de bouger,
ça permet de vivre, de changer de territoires musicaux.»
- «Vous avez pourtant fait un détour...»
- «Après l'album symphonique Ailleurs, en 1989,
j'ai eu envie de rock, mais il y a eu Un homme heureux, un exercice de
musique au piano. J'avais commencé Albion avant. Le piano-voix
était une rupture volontaire dans mon parcours, car j'ai toujours dit non
aux étiquettes. A chaque fois que l'on change de registre et de genre,
le résultat parvient à des oreilles plus sensibilisées. A
chaque fois, il y a des gens qui apprennent qui est Sheller, car je viens dans
leur région musicale. Et là, ça se complique. Comment fédérer
tout ça ? J'aurais pu exploiter le système piano, je pourrais encore
faire de chouettes chansons. Mais l'image me paraissait un peu triste et je suis
curieux.»
- «L'électricité,
est-ce un moyen d'éclairer un propos parfois éthéré
?»
- «J'avais besoin de travailler avec d'autres
images. Les chansons d'Albion pourraient d'ailleurs être jouées
au piano, ou autrement. Il existait une version symphonique d'Excalibur,
une chanson de geste, que je reprends ici de manière plus agressive. Les
guitares ont des sons grunge, mais les mélodies sont très importantes,
ce qui nous ramène aux années 60. Une époque très
riche, où, par exemple, la stéréo était utilisée
en tant que telle, où on avait plaisir à faire passer les sons d'un
côté à l'autre. Aujourd'hui, on en est plutôt au grand
mono statique. On s'en tient au climat sonore. D'où le retour en force
des années 60, un âge d'or où le rock était une distraction,
mais aussi une recherche permanente, une dynamique. Où il ne véhiculait
pas autant de dires, alors qu'aujourd'hui, les mots prennent parfois le pas sur
la musique, comme dans le rap. Or, Albion est un retour vers la légèreté.»
- «Vous avez choisi d'enregistrer
Albion avec David Ruffy (batterie, percussion), Gary Tibbs (basse), Steve
Boltz (guitares). Mark Wallis a produit l'album. Comment avez-vous travaillé
avec des musiciens dont l'univers est si différent du vôtre ?»
- «En Angleterre, Sheller est un inconnu, d'ailleurs je n'y avais
jamais mis un pied. En France, les musiciens, sous prétexte que j'écris
des symphonies, n'osent pas bouger une note. Cela dit, la séparation entre
le classique et la variété se fait moins sentir aujourd'hui. On
admet que les musiciens soient comme les pâtissiers qui doivent savoir confectionner
toutes sortes de gâteaux. Or, moi, j'ai besoin d'apprendre. Et, puisque
ces musiciens-là ne lisaient pas la musique, je n'ai pas écrit l'album
en totalité. Je leur ai montré sur un clavier note après
note ce à quoi je tenais. Ce qui les étonnait, c'était les
changements d'accords qui ne correspondent pas à leurs habitudes. Des modulations,
des surprises: on attend qu'un accord passe d'un côté, il s'en va
de l'autre. Ils disaient : «Quand on veut jouer une chanson de Sheller,
on est obligé de l'apprendre». Puis, j'ai écouté
leurs avis, notamment sur la mise en place des instruments. Avec leur énergie
et leur sens de l'improvisation - qui me fait défaut -, ils m'ont permis
d'envisager qu'il puisse y avoir des erreurs dont on profite, de l'aléatoire.
Ensemble, nous avons déplacé des motifs, construit l'album bloc
par bloc.»
- «Vous parlez de
la musique comme de l'architecture...»
- «Oui.
La musique ne se conçoit pas, elle s'entend. On écrit un petit bout,
tout en ayant une vision d'ensemble de quelque chose que l'on ignore encore. En
écrivant des pages symphoniques, par exemple, on a l'impression d'être
comme les paléontologues, qui à partir d'une vertèbre reconstruisent
tout un squelette. On a une vision du tout, puis on gratte, on travaille, on déplace
des blocs et l'on fabrique des monstres. Avant je les commençais sur l'ordinateur,
et je continuais à la main. Aujourd'hui, je travaille directement sur la
machine. Ça change.»
- «Pour
Albion, vous avez mis en avant les mélodies et les guitares, la voix
est très en retrait. Cela donne une impression de dissolution.»
- «Tout cela fait partie du tableau. Nous avons enregistré
Albion dans la campagne anglaise, à Ridge Farm, une grange aménagée
en studio, dans le Surrey, au sud-ouest de la Grande-Bretagne. J'y ai vécu
toutes les saisons. Nous avons commencé en mai, et terminé à
l'hiver. Un an de vie. Nous avons fini par constituer un groupe, une famille,
et l'interprète s'est mis en arrière naturellement. Comme dans l'album
symphonique Ailleurs, l'acteur est dans le décor, la voix effacée,
à sa juste place. A l'image des paroles : tout est en haut, vu de l'extérieur.
Quand on se promène dans la musique, on peut se promener dans les cités,
les rues, voir les gens du quotidien, on peut aussi aller dans les ministères
quêter des subsides. Moi, je ne me sens appartenir à aucun de ces
mondes. Je suis un satellite.»
- «C'est
ce que vous vouliez dire dans vos chansons ?»
- «Deux
des chansons de l'album ont un regard un peu plus social, Les Enfants sauvages,
une légère touche, en évitant la démagogie, et vers
la fin, On vit tous la même histoire. Comme dans Un homme heureux,
le «je» n'était pas pris à la première personne
: j'ai vu des gens vivre comme ça. Je ne me réfugie pas derrière
le doute, mais le chanteur n'en sait pas plus que les autres parce qu'il passe
à la télévision. Je suis plus obsédé par la
musique que par ce qu'elle peut véhiculer. Je cherche pourtant à
trouver un langage commun, un sens partagé des mots. Or, aujourd'hui, j'ai
le sentiment que nous lâchons pied sur terre et que nous nous en accommodons.
Nous pensons en termes de géographie, alors que les moyens de communication
ont déjà largement supprimé cette notion. Les peuples sont
des peuples virtuels, des couches superposées qui ont leurs canons vestimentaires,
leur cinéma, leur littérature. Plusieurs mondes, des lobbies, vivent
en parallèle dans le même lieu. Dans tous les pays, il y a des yuppies,
il y a des affamés, des hardrockers, avec les mêmes vêtements
partout. Chaque mode est un monde qui vit dans son coin.»
-
«Vous ne vous sentez pas impliqué dans la politique au quotidien
?»
- «Concerné, comme tout être
humain, par ce qui se passe ici sur terre. J'ai soutenu l'association Aides,
Amnesty International, mais pas forcément à Paris, pas
pour le charity-business. Un concert ne coûte rien, surtout au piano. La
compilation Sida Urgence [où Sheller interprétait Vienne,
de Barbara] était une très bonne idée : chacun y avait
créé un titre, c'est mieux que de chanter à quinze ensemble.
Mais, l'an passé, j'ai beaucoup travaillé, et peu réfléchi.
Mon Concerto pour trompettes et orchestre a été créé
à Pleyel par l'Orchestre des concerts Lamoureux, dirigé par Yutaka
Sado. Puis, j'ai terminé la musique - pour quatuor à cordes et piano
- du film l'Ecrivain public, de Jean-François Amiguet.»
- «Aimez-vous composer pour le cinéma
?»
- «La musique de film est plus cernée,
plus serrée. Je regarde les images sur la table de montage avec le réalisateur,
on découpe, il suggère. L'idée du réalisateur prime,
je travaille sur un cahier des charges. Tous les compositeurs ont toujours travaillé
pour leur commanditaire, et après, leur talent et leurs propos personnels
transparaissaient. Mais à présent, le talent du compositeur passe
avant. C'est dommage. Même la publicité est un exercice intéressant
: 10 secondes d'un sentiment positif, 3 secondes d'atmosphère joyeuse.
J'ai composé peu de musiques pour le cinéma, plutôt pour des
comédies, à commencer par Erotissimo, de Gérard
Pirès, en 1969, grâce à la défection de Polnareff.
Car à Sheller chanteur, on a souvent demandé une petite musique
sympa. Mais, j'aime le cinéma quand l'imaginaire domine: j'adorerais travailler
sur des péplums. Ah ! Ben Hur !»
-
«Qu'est-ce que vous écoutez chaque jour ?»
-
«La musique, le silence : j'écoute tout. Arvo Part, Beethoven, les
disques de rock de mon fils, et pendant ce temps, je gribouille, je fais des dessins
pour éviter d'analyser. C'est une drôle de période, et les
musiciens sont le reflet de la bousculade. Il n'y a plus une histoire de la musique,
il y en a cent.»
- «Et la musique
contemporaine?»
- «J'écoute moins les
créations, je suis toujours déçu, on entend toujours cette
même œuvre angoissée dans toutes les créations contemporaines.
J'écoute Boulez en lisant la partition, c'est déjà difficile.
J'aime beaucoup Arvo Part. Mais là où Boulez a inventé un
langage, j'avoue que Part a emprunté à Stravinsky. Dusapin est intéressant.
Brian Eno, aussi. Nous en sommes aujourd'hui au symphonique alternatif.»

Albion,
1 CD Phonogram 518963. Carnet de notes, 1 coffret de 4 CD Phonogram 514761. Sheller
en solitaire, 1 CD Phonogram 848786.
|
ALBION,
de William Sheller
Roule, Britannia
(par Thomas Sotinel) Après
le dépouillement de Sheller en solitaire,
voici l'autoportrait de William en rocker. Contrairement
à tant de ses
compatriotes, l'artiste n'est pas parti chercher l'élixir du rock'n'roll
à Memphis (Tennessee) ou à La Nouvelle-Orléans
(Louisiane). Pour
Sheller, le rock est d'Angleterre, il se joue avec des Anglais (ici une bande
de requins de studios) selon des règles aussi précises
que celles du cricket, établies dans les années 60 et légèrement
amendées
au fil du temps.
On l'aura compris, Albion ne
joue pas à la modernité. Mais William Sheller est trop fin pour
s'abriter sous le parapluie de la nostalgie. On reconnaîtra donc au long
de ces dix chansons l'héritage des Beatles, celui du Pink Floyd première
période, mais aussi des motifs ou des sonorités plus contemporains
qui évoquent les derniers disques de U2
(le traitement de la voix) ou
Kate Bush (les guitares).
Mais pour quoi
faire ? Pour une fois la manœuvre ne sent pas la mégalomanie. Ici,
pas question de conquête du marché américain, ce passage du
nord-ouest de la variété française. Il faut se rendre à
la simple raison d'une envie de rock. Sheller voyage comme bon lui semble. Il
transporte toujours les mêmes bagages, son obsession de la solitude, son
scepticisme quant à l'utilité du langage. Seuls les véhicules
changent, orchestre symphonique ou piano solo. Ici, le groupe de rock'n'roll s'est
un peu emballé, on dirait que le conducteur s'est laissé entraîner
par la grosse machine. D'abord, sa voix blanche se perd dans le fracas électrique.
Ensuite, ce fracas, organisé avec une maniaquerie perfectionniste par le
producteur Mark Wallis, finit par cacher les chansons.  |