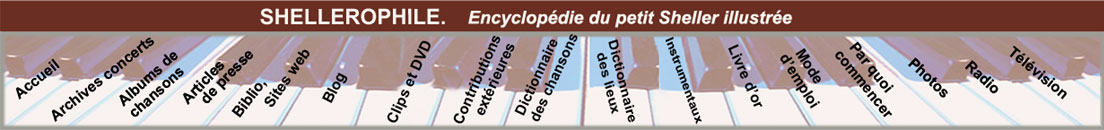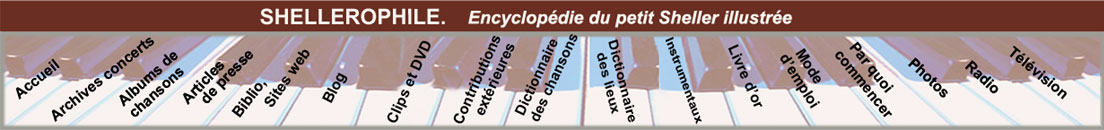L’un des plus grands noms de la chanson française publie son autobiographie. L’auteur, compositeur et interprète des fameux Un homme heureux, J’cours tout seul, Le carnet à spirale et autres perles comme La navale, Centre-ville ou Chanson lente, retrace sa drôle de vie dans William, sorti en mars aux Editions des Equateurs. Se prêtant au jeu des confidences et allant surtout au bout de son art à lui, transmettre des impressions et des émotions dans leur vérité crue, l’artiste détaille son parcours inimaginable, bousculé par tant d’événements et de personnalités. William Sheller, un homme émerveillé et autant ému qu’émouvant, a accepté avec plaisir notre demande d’entretien. Découvertes sur son père, bisexualité, passion de la composition, hypersensibilité, cocaïne, critique de l’époque actuelle: aucun sujet n’est évité sur une vie écrite en lettres capitales, à l’encre bleue.
- Le Regard Libre : « Pourquoi avoir choisi d’écrire votre autobiographie ? »
- William Sheller : « J’ai été frustré pendant très longtemps des interviews que j’ai accordées au sujet de ma musique. On ne savait rien du bonhomme. Je représentais une marchandise, j’étais un homme-sandwich. Une émission de télévision se résumait à cela: "Vous venez de sortir un nouvel album, qui s’appelle tsouin-tsouin, n’est-ce pas ? Il a tel nombre de titres, n’est-ce pas ? Vous faites une tournée ensuite ? Vous passez par là et par là…" et ainsi de suite. "Et maintenant William Sheller va nous chanter sa chanson." Et c’était déjà le déroulement de fin d’émission. Le reste consistait en des extrapolations et ragots de journaux médiocres. J’en ai eu marre et j’ai voulu parler non pas tant du métier que du bonhomme, du gamin qui a été bouleversé par un tas de choses dans sa vie et qui a traversé les Trente Glorieuses. Il s’agit donc de William aussi bien que des périodes qu’il a vécues.
- « Le Regard Libre : « On accède avec vous aux coulisses du star-système: vos amis de fête, comme Nicoletta ou Patrick Juvet, mais aussi des rencontres plus rares, comme celle de Johnny Hallyday, "plus fin que ce qu’ont pu en dire les médias". Le showbiz, vous l’avez détesté. En partie pour le fossé qui se creuse inéluctablement entre la personne, la vraie, et son image publique ? »
- William Sheller : « Oui. On est là pour représenter un produit. Et quand on s’en éloigne, ça dérange. Ce qui est embêtant pour quelqu’un comme moi qui a souvent été flirter du côté de la musique symphonique. "C’est ennuyeux ça, on aurait pas un album pour cet hiver ?" Enfin, ce n’était pas mon boulot ! Je ne voulais pas être une star, moi, je voulais être un compositeur. Je suis devenu un chanteur un peu par hasard. Et quand j’ai sorti des chansons piano-voix comme Un homme heureux, ma maison de disque trouvait qu’elles étaient tristes. Ils n’ont rien compris à cet homme heureux que je traîne comme une casserole. »
- Le Regard libre : « D’ailleurs, vous ne mentionnez pas une seule fois cette chanson phare dans William. »
- William Sheller : « Oh non, on m’a assez demandé d’en parler! » [Rires]
- Le Regard Libre : « Parlons donc de ce qui ouvre votre livre: votre mère qui, sur son lit de mort en 1996, vous annonce que votre père n’est pas votre père. Quel bouleversement cela doit être ! »
- William Sheller : « Un bouleversement terrible. Ma mère m’apprend, l’air de rien, en mode " Ah oui, et…", avant ses derniers soupirs, que mon vrai père était un soldat américain qu’elle a rencontré au moment de la Libération. Je venais de naître quand il a dû partir avec son régiment pour Le Havre. Il était démobilisé. Quand il est revenu en France après son divorce, il n’a retrouvé personne, car ma mère m’avait "kidnappé" et nous avait emmenés vivre à un autre endroit. Mon père m’a cherché pendant des années, en vain. »
- Le Regard libre : « Cela dit, bien avant 1996, vous aviez déjà des doutes sur le fait que quelque chose clochait. »
- William Sheller : « Effectivement. Je me suis souvent dit que je n’avais rien à voir avec cette famille de dingos qui m’a donné mon nom civil, Hand. Franchement, entre l’une qui recevait Jésus dans son salon et l’autre qui était alcoolique et parlait avec les Martiens, il fallait voir ! Ma mère Paulette et son homme étaient tellement dans l’amour de l’autre, mais en mode "je t’aime moi non plus", qu’ils se séparaient au bout de trois ans, puis pouf, ils se recollaient. "Oh, on a eu une idée de commerce, on fait venir des voitures d’Amérique, on leur fait construire des plaques d’immatriculation par un copain qu’on connaît. » Tout cela partait en l’air évidemment. C’était sans arrêt ! Et qui en assurait les frais, sur le plan financier ? Moi. Aussi, les nombreux non-dits qu’il y avait à la maison m’ont mis la puce à l’oreille même si j’étais encore un enfant. »
- Le Regard libre : « Après cette confidence de votre mère, quand avez-vous commencé à faire des recherches sur l’identité de votre père, dont elle vous a dit qu’il s’appelait Colin et qu’il venait du Michigan ? »
- William Sheller : « Dès le lendemain de la nouvelle. Evidemment, le Michigan, c’est loin, mais internet commençait à se développer, j’ai donc fait des recherches sur les sites et j’ai trouvé une adresse. Mais à quoi bon intervenir dans une famille certainement déjà formée ? Quel mauvais feuilleton. Mon père était réputé avoir au moins 80 ans: quel impact mon arrivée de nulle part allait-elle avoir sur sa santé ? En 2004, au moment du soixantenaire du débarquement de Normandie (de l’invasion, comme diraient les Américains), je me suis décidé à lui écrire. »
- Le Regard libre : « Quelle réponse avez-vous reçue? »
- William Sheller : « Je ne m’attendais pas à en obtenir une. Pourtant, quinze jours après mon envoi, j’ai reçu une immense enveloppe provenant des Etats-Unis, avec une lettre, des photos de la famille, etc. Mon père Colin Thomas MacLeod était décédé en 1989. Je suis allé voir sa famille, ma famille, en 2006, car j’avais des engagements jusque-là. Quand je suis arrivé, mes cousins disaient: "Oh, qu’est-ce que tu ressembles à oncle Colin !" A présent, je fais partie du clan des MacLeod. J’ai le droit à des cours de macléodisme. Et ma sœur m’a même dit: "Nous avons acquis, dans le carré des MacLeod, un espace pour tes cendres." (Rires)
- Le Regard libre : « Si le fil rouge de votre autobiographie, par définition, est votre vie, on en apprend beaucoup quant au regard que vous portez sur votre œuvre. Typiquement, il y a clairement des albums que vous préférez à d’autres, non ? »
- William Sheller : « Oui. Il y a d’abord l’album Nicolas que j’ai réalisé à Los Angeles en compagnie de musiciens d’Elton John et de Bob Dylan et qui est sorti en 1980. Pour ce projet, j’ai quand même travaillé avec les guitaristes Steve Lukather (du groupe Toto) et Micky Jones, ou le batteur Jim Keltner (ancien musicien de Ringo Starr)! Ensuite, l’album Univers, paru en 1987, est un autre opus qui compte énormément. La raison en est simple: on m’a donné tous les moyens de le réaliser comme je l’entendais. Comme, à mon label, on ne savait plus à quel saint se vouer avec moi, on m’a donné carte blanche. J’ai ainsi pu faire le mélange que je souhaitais d’influences qui m’intéressaient: la musique japonaise, la pop, la musique du XVIIe siècle… La chanson Le Nouveau monde, dans laquelle je respecte les règles de la musique du XVIIe siècle, est le résultat d’une étude que j’ai réalisée pour l’histoire de l’orchestration. Il fallait bien que je m’en serve pour une chanson ! »
- Le Regard libre : « En revanche, j’ai saisi la mesure de votre répulsion envers votre dernier album, Stylus (2015). Il contient pourtant des titres magnifiques: Youpylong, Bus stop, Les enfants du week-end…
- William Sheller : « Oui, ce sont des chansons importantes, mais elles ne sont pas terminées ! Vous ne pouvez pas imaginer ma frustration à l’égard de ce gâchis. J’étais cloué dans un lit d’hôpital, avec des tuyaux partout. Pendant ce temps-là, des crétins ont bricolé les sons de mon album. En plus, une compilation épouvantable a été publiée! J’ai déclaré dans la presse à ce moment-là qu’il ne fallait pas acheter ce machin, mais le voler. Je le pense toujours. »
- Le Regard libre : « Vous décrivez dans le détail ce que vous appelez le "vertige de la création". Tout à coup, l’espace d’une seconde, vous avez en tête une séquence musicale, très courte, parfois entièrement orchestrée. Il s’agit ensuite de l’écrire et de la développer. N’y a-t-il pas une dimension de frustration par rapport à la séquence parfaite que vous aviez en tête ? »
- William Sheller : « Pas vraiment. Comme tout travail, l’écriture musicale, ça s’apprend. Si l’on a dans sa tête une maison, il faut apprendre l’architecture pour la bâtir. Ce qui se passe dans le domaine de la composition est tout à fait fascinant. On entend un petit truc qui revient et revient. Tout à coup, on se demande pourquoi ça revient et ensuite on en prend conscience. Mais on ne sait pas si c’est le début d’un morceau, la conséquence d’un autre motif ou autre chose encore. J’ai noirci énormément de pages de papier à musique. Cette dimension calligraphique fait que ce n’est pas la même chose de composer sur papier ou de composer avec l’ordinateur ou le piano. On est plus libre en écrivant et cela donne des résultats moins facilités, donc moins faciles. D’ailleurs, quand il s’agit d’écrire un concerto, alors c’est quelque chose. Cent cinquante pages d’orchestre à la main, bonjour le boulot. A ce sujet, je suis aussi fier de ce livre de 500 pages dont nous sommes en train de parler que j’ai pu l’être d’un concerto. »
- Le Regard libre : « Parlons aussi de textes, et d’un mot en particulier: "jardin". C’est un motif qui revient souvent dans votre œuvre. Est-ce, comme peut nous le suggérer votre livre, parce que les jardins ont beaucoup compté dans votre vie ? »
- William Sheller : « Sans doute. Quand j’étais gosse, j’allais dans le jardin du frère de ma mamy, que j’appelais "Tonton" et qui était une sorte de Mamy en homme. Ce lieu était un véritable havre de paix, que je ne retrouvais pas à la maison. L’épouse de Tonton, Tata, était gardienne d’un immeuble occupé par des religieuses. Nous avions le droit de nous rendre dans le jardin, car il y avait une fontaine avec des poissons, mais il ne fallait pas faire de bruit pour ne pas déranger les religieuses qui priaient. J’en garde un souvenir très fort ! Et puis, bien des années plus tard, quand j’habitais dans un appartement du 17e arrondissement, j’ai connu le remarquable parc Monceau, qui a été complètement inventé par Napoléon III. C’est là que j’ai écrit, entre autres chansons, Le témoin magnifique, en regardant les joggers partir le matin.»
- Le Regard libre : « Et il y a un jardin où vous avez rencontré une personne importante dans votre vie. »
- William Sheller : « Peter. Nous sommes à la fin des années 70, environ. Je suis bien éméché et traverse le Champ-de-Mars à pied, la nuit. Tout à coup, dans les images troubles qui étaient celles de cette nuit-là, je vois des couleurs s’approcher, formant peu à peu une silhouette, qui pour finir était la mienne ! Et j’ai donc eu l’impression de me croiser moi-même. Je me suis dit que j’allais faire un malaise. Mais c’était un inconnu qui me ressemblait beaucoup, qui après m’avoir évité (et reconnu), m’a suivi. Je suis allé jusqu’à la gare Montparnasse et là j’ai senti une main sur mon épaule. L’inconnu : "Bon, alors on va jusqu’où comme ça?" C’était Peter, qui est venu passer la nuit chez moi.»
- Le Regard libre : « Et vous avez fini par dormir souvent ensemble. Il s’est installé chez vous. Vous avez partagé votre vie entre lui et Nelly, une femme qui trouvait très bien que vous ayez aussi un homme à vos côtés. Ce n’était pas votre amant. Comment comprendre cette relation ? »
-William Sheller : « J’ai entretenu avec Peter une forme d’amour que les spécialistes appellent "homoromantisme". C’était mon frangin, mon double. J’aurais toujours voulu avoir un frère, sur lequel me reposer. Peter m’apportait une énergie, alors que Nelly, d’un autre côté, prenait une énergie que je donnais volontiers. J’avais mon yin et mon yang. Et ce n’était pas un trio ou quoi que ce soit de ce style. Lorsque j’étais avec l’un, l’autre se retirait un peu. Je ne me suis jamais retrouvé sur les genoux d’un père. Quand j’étais tout contre Peter, cela me donnait l’impression qu’on a, gamin, quand on embrasse un arbre. »
- Le Regard libre : « Etait-ce un amour platonique ? »
- William Sheller : « C’était un peu plus que cela. Parfois, quand je me réveillais, il avait sa tête posée sur ma poitrine. Il y avait des câlins et beaucoup de tendresse. Mais je n’ai jamais été fan de gymnastique suédoise, pour ainsi dire ». [Rires]
- Le Regard libre : « De la même façon, avez-vous vécu avec la chanteuse Barbara, un autre personnage-clé de votre vie, une forme d’hétéroromantisme ? »
- William Sheller : « On pourrait dire cela, oui. C’est la personne avec qui j’ai vécu les plus hautes transmissions de pensée. On se comprenait à la perfection. Notre affection était totale, mais sans désir. On me rappelle souvent que j’ai vécu avec Barbara. C’est faux: j’ai vécu chez Barbara. Nuance d’importance. Cette intimité qui s’est déclenchée en 1973 a beaucoup compté. J’ai réalisé, sur son invitation, les arrangements de son album La Louve. Pour cela, j’ai logé chez elle. Et c’est elle qui, dans le cadre de cette collaboration, m’a dit un jour en claquant son poudrier: "Tu devrais chanter, toi". Je lui ai répondu que je n’avais pas de voix. "Et alors? Moi non plus, on s’en fout", m’a-t-elle fait. "Tu es diseur comme moi je suis une diseuse. Je raconte des histoires en musique et je les fais vivre." J’ai suivi son conseil; on ne peut pas désobéir à une femme qui claque son poudrier. Elle m’a ensuite aidé à trouver une maison de disque. »
- Le Regard libre : « Bouclons la boucle des jardins: si je dis, en citant votre chanson Les petites filles modèles, "C’est dans ce jardin qu’autrefois / Dans mes habits de joueur d’escrime / Je v’nais souvent apprivoiser les chats / Qui s’dandinent ", qu’est-ce que cela vous évoque?»
- William Sheller : « Je pense immédiatement à ces moments où je devais aller chez la famille aristocrate de l’industriel qu’avait rencontré ma mère – et qui n’était pas le plus représentatif de la famille–. J’essayais de tenir ma position et ce qu’on pouvait en attendre. "Les habits de joueur d’escrime", ce sont les déguisements que je portais. Quant aux chats, il y en avait effectivement, à qui de vieilles dames donnaient à manger, dans les jardins. »
- Le Regard libre : « On vous devine hypersensible. »
- William Sheller : « Je le suis. Cette démarche, qui consiste à tenter de faire de belles phrases avec de petits riens, est la même que celle d’un Charles Baudelaire. C’est toujours mieux que les tubes de l’été en mode "J’attends un taxi, je bois mon café, gnagnagni et gnagnagna…". Quand je vois certains produits issus d’émissions comme The Voice, je me fais du souci. Il suffirait d’avoir un physique avantageux, des cheveux lissés brésiliens, pour chanter. Quelle vulgarité, quand on pense ! »
- Le Regard libre : « On ne citera personne. »
- William Sheller : « Oh non, parce qu’il y en a trop. » [Rires]
- Le Regard libre : « C’est certain. Etes-vous un mélancolique? »
- William Sheller : « Disons qu’il faut remplir sa vie. On vient au monde en étant aveugle, puis on commence à comprendre que papa c’est celui avec les moustaches, maman celle avec les cheveux longs, et ensuite il faut meubler cette existence… Quand on a la chance d’avoir une passion et de pouvoir en vivre, alors on doit admettre que la vie, c’est bien. Il n’y a rien à dire de plus. Par contre, je pense beaucoup aux individus qui n’ont pas de chance déjà à la base. J’ai plus de mansuétude pour les autres que pour moi-même. Les choses ne me blessent pas. Je ne pleure pas, sauf quand j’épluche des oignons – ah oui, et je pleure aussi au cinéma, mais ça, ne l’écrivez pas. » [Rires]
- Le Regard libre : « On a beaucoup parlé de musique classique, mais discutons de rock. Peut-on considérer que c’est votre autre famille musicale ? »
- William Sheller : « Oui. Qu’est-ce que j’aime le rock ! Par contre, en France… ce n’est pas trop ça. Lorsque je suis allé enregistrer un album aux Etats-Unis, et un autre en Angleterre, vingt ans plus tard [NDLR: l’album Albion sorti en 1994], on m’a demandé pourquoi je ne voudrais pas m’y installer. Eh bien, oui, mais non, parce qu’il y a la famille, les enfants. Ce n’est pas facile de changer comme ça de pays. »
- Le Regard libre : « Ce n’était pas non plus facile de résister à la tentation de la cocaïne, notamment avec vos copains du rock. Vous en avez consommé pendant des années. Malgré le tableau sympathique que vous dressez de cette drogue, vous ne recommandez quand même pas son usage à nos lecteurs, rassurez-moi ? »
- William Sheller : « Je ne la recommande à personne; je n’ai surtout de leçon à donner à personne. Mais il faut préciser qu’avant, les produits étaient beaucoup plus… bio, disons. La cocaïne me donnait du punch. Par exemple, au Paléo Festival de Nyon, je me suis retrouvé devant 50’000 personnes. En face, il y avait cette colline ! Oh là là, d’accord, que je me suis dit. Un peu d’aide ne me ferait pas de mal. Mais sinon, je n’en prenais pas pour regarder la télévision, vous voyez. Chose qui aurait été complètement ridicule. »
- Le Regard libre : « La poudre a joué un rôle dans les ennuis de santé que vous avez eus plus tard, non ? »
- William Sheller : « Certainement. D’ailleurs, j’ai toujours été honnête avec mon médecin. Je lui disais tout. Je prenais un centimètre de temps en temps, cela suffisait. La cocaïne, c’était l’époque. Rappelons-nous que ce fut celle des grandes transformations, de la démocratisation de la musique – à réécouter inlassablement – ainsi que de la fumette et du LSD. On cherchait une nouvelle forme de spiritualité, un peu comme les romantiques au début du XIXe siècle. »
- Le Regard libre : « Quelle autre caractéristique associeriez-vous à ces Trente Glorieuses par rapport à l’époque que nous traversons aujourd’hui ? »
- William Sheller : « Liberté. Il y en avait beaucoup plus qu’aujourd’hui de manière générale. Notre expression était plus libre, la création était plus libre, la presse était plus libre, l’humour était plus libre. On parle parfois des Trente Glorieuses sans trop savoir ce que c’est, en n’y voyant que des vieux qui ont dépensé tout l’argent, des boomers. Mais les interdits en tout genre de la société actuelle ne sont pas très heureux. La musique d’aujourd’hui est la preuve qu’on ne peut plus tout dire et même qu’on ne peut presque plus rien dire. Il faut rester abstrait et urbain. Il n’y a donc plus beaucoup de place pour le rêve. Idem pour le cinéma et la littérature. Heureusement, on n’en est pas encore au stade des Américains, où la vue d’un sein est devenue intolérable. Mais on arrive peu à peu à ce puritanisme, hélas. Ce que notre époque va devenir, je n’en sais rien et je ne serai plus là pour le voir, mais je me fais du souci pour mes petits-enfants. »
- Le Regard libre : « La liberté, vous en usez dans votre ouvrage, qui est écrit comme vous parlez. On sent que c’est vous qui l’avez rédigé et ce n’est de loin pas la règle chez vos confrères… »
- William Sheller : « Il n’est pas possible de restituer une émotion, un parfum, une odeur, une moiteur, le sentiment de se trouver bloqué parmi des personnes, sans qu’il s’agisse de mots à soi. Ces mots, on les cherche parfois très longtemps. La grande écrivaine Colette estimait que c’est une horreur d’écrire – et c’est vrai. Qu’est-ce qu’une autobiographie si elle ne consiste qu’en des "J’ai rencontré un tel, ensuite j’ai rencontré une telle" et ainsi de suite ? Que voit-on, que ressent-on de la vie d’une personne ? »
- Le Regard libre : « "Pour l’instant, disons que ce livre est fini", écrivez-vous à la fin. On lit entre les lignes… »
- William Sheller : « Eh oui ! Je vous le donne comme ça: il y aura un tome 2, aussi centré sur l’individu mais plus sur le plan professionnel pour ainsi dire, dans le mouvement qui s’est produit musicalement des années 60 jusqu’à ce que ce soit le début de la décrépitude. Oui, parce que bon, voilà. »
- Le Regard libre : « Et il y a encore beaucoup de choses à raconter. J’ai par exemple été étonné de constater l’absence de Véronique Sanson. »
- William Sheller : « Totalement ! En fait, il y a des personnes dont la proximité est tellement évidente que je les ai complètement zappées. Véronique Sanson en fait partie. Elle et moi sommes infiniment liés affectivement et musicalement. Nous sommes deux personnes relativement borderline. Nous nous suivons et en même temps nous nous cherchons. C’est assez compliqué. »
- Le Regard libre : « Elle était présente en 2016 aux Victoires de la Musique lorsqu’on vous a remis la Victoire d’honneur couronnant vos 40 ans de carrière. Qu’a signifié cette soirée pour vous ? »
- William Sheller : « Je ne voulais pas y aller. Je me trouvais dans un piteux état suite à mon burn-out qui s’est déclenché en 2014 et a débouché sur une arythmie cardiaque et un œdème pulmonaire. Gonflé par la cortisone, je pesais 100 kilos. J’étais devenu une sorte de monstre. Mais les retours que j’ai reçus sur ce soir-là ont été bouleversants. Véronique Sanson m’a sauvé la vie, d’ailleurs, quand j’ai failli louper une marche de l’escalier descendant de la scène. Sans cet ange gardien, je me serais fracassé le crâne. »
- Le Regard libre : « Vous avez décidé de ne plus jamais chanter. Qu’est-ce qui a motivé cette décision ? »
- William Sheller : « Quand je me suis remis de ma maladie, j’ai vécu cette guérison comme une forme de mort initiatique: d’un seul coup, on meurt pour renaître autrement. En 2018, un autre moi est né. Vous savez, j’aurai 74 ans en juillet de cette année. Il me reste donc, allez, dix, quinze, maximum vingt ans pour composer de la musique. C’est l’équivalent de la vie d’un chien! Je me suis dit: je ne vais pas aller fourrer ma truffe là où ça ne m’intéresse pas. »
- Le Regard libre : « Comment allez-vous vous occuper désormais ? »
- William Sheller : « En faisant strictement ce que je veux. En transmettant, car c’est important et c’est le moment de le faire. En écrivant, toujours, mais pas des chansons que je vais interpréter: des textes, comme le livre dont nous parlons, ou de la musique. J’ai beaucoup de séquences qui me trottent dans la tête. Mais je ne chanterai plus jamais et je ne jouerai plus de piano. A tel point que j’ai vendu le mien, sur lequel j’ai composé Un homme heureux. Le nouveau piano que vous voyez derrière moi me sert juste à vérifier si une note est un do, comme je n’ai pas l’oreille absolue. C’est un outil pour composer. Mais je ne joue plus. Je ne sais pas pourquoi. Désormais, j’écoute. Je redeviens un mélomane. »
- Le Regard libre : « Quelle musique écoutez-vous ? »
- William Sheller : « De la musique classique, qui m’a ébloui durant ma jeunesse, mais aussi des titres qui sortent aujourd’hui, malgré tout ce que j’ai dit avant. J’adore Eddy de Pretto. Ses textes sont parfois proches d’un Rimbaud. »
- Le Regard libre : « Au final, diriez-vous que votre côté original vous a plutôt aidé dans votre vie ou plutôt joué des tours ? »
- William Sheller : « On pourrait résumer ma non-réponse au fameux titre d’Emil Cioran: De l’inconvénient d’être né. » 
* William Sheller/ William/ Editions des Equateurs. 2021. 489 pages.